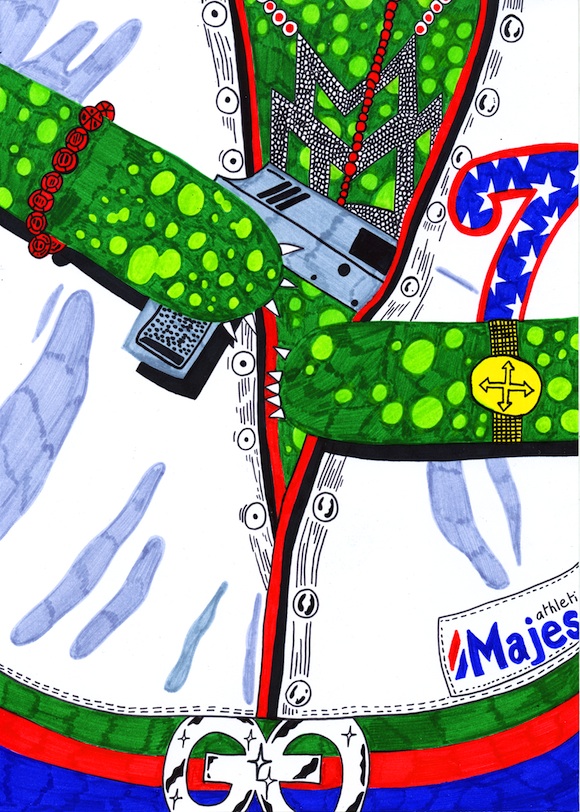Faire battre le cœur de Washington D.C.
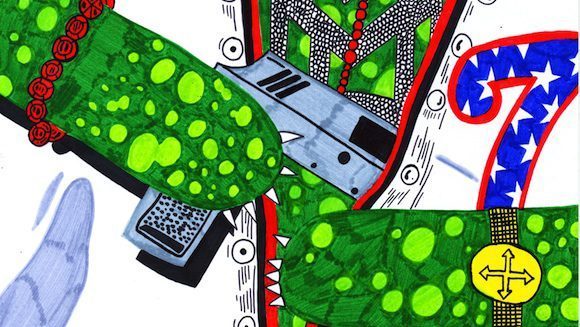
Lors de l’investiture de Donald Trump, les prises de vues aériennes du National Mall montrent une foule clairsemée. Ce président n’est pas celui de la majorité des américains, mais si les rues sont moins denses que pour un discours de Barack Obama, c’est aussi sous l’effet d’une singularité régionale. La population du D.M.V. (pour D.C., Maryland, Virginie) est dans sa majorité afro-américaine, ces états ayant accueillis des noirs venus du Sud notamment, où les droits civiques évoluaient plus lentement qu’au Nord. Et c’est un secret pour personne, Trump est le choix des électeurs blancs.
Les tirs qui ont forcé GoldLink à fuir sont malgré tout bien réels, symptôme d’une rivalité entre les quatre points cardinaux de la ville
Cette particularité démographique a inspiré le sobriquet de Washington D.C., dite « Chocolate City » depuis que George Clinton la surnomme ainsi en 1975. En y important leurs musiques et traditions, les migrants ont fait de Chocolate City et de tout le D.M.V. une marmite où bouillonnent les cultures afro-américaines au pluriel. Pendant plusieurs décennies, cette zone fertile donne naissance à tout un répertoire de sous-cultures et de genres musicaux. Chacun à leur manière, les rappeurs de Washington D.C. portent aujourd’hui l’héritage de cette histoire qui a silencieusement mais profondément impactée la musique américaine.
À la fin de Meditation, GoldLink est piégé dans une soirée interrompue par des coups de feu. C’est le genre d’incident qui a justifié la fermeture du Club U, dont la réputation s’est dégradée au fil des ans. Le durcissement du discours sur ces lieux de vie de la population noire va de paire avec la gentrification de Washington D.C., qui modifie les quartiers en même temps que la couleur de peau de l’habitant moyen. La fermeture du club correspond d’ailleurs au moment précis où pour la première fois depuis le milieu du XXème siècle, la population du district est devenue à moitié caucasienne. Les tirs qui ont forcé GoldLink à fuir sont malgré tout bien réels, symptôme d’une rivalité entre les quatre points cardinaux de la ville. Ce jour-là, il venait de tomber sous le charme d’une jeune inconnue originaire d’un quartier ennemi, et ses tentatives de séduction ont mis de l’huile sur le feu qui fait fondre Chocolate City. Ce remake moderne et urbain de Roméo et Juliette est mis en scène tout au long d’At What Cost, où GoldLink énumère les souvenirs de ses amours présentes et passées, pour mieux rendre hommage à son territoire d’origine et de cœur. Et si ces filles dont il tombe amoureux n’étaient que différentes facettes de cette région qu’il chérit tant ?
Pour enregistrer cet album, GoldLink a quitté la Californie où il vit depuis le début de sa carrière, afin de capter l’atmosphère de sa ville natale. Les rythmes sont gorgés de percussions superposées, secouant un gumbo de funk, trap, r’n’b et musiques électroniques. Hands On Your Knees nous projette dans la foule d’une soirée go-go, un sous genre de funk dont les congas et timbales font battre le cœur de D.C. depuis les années 1970. Dans cette chanson, on entend les cris de Kokayi, lead talker go-go, qui harangue le public et les musiciens pour les faire dialoguer, et construire la fête ensemble. Le go-go est une musique collective, à la fois extension de chaque individu et synecdoque de toute la communauté. GoldLink refait germer cette idée pour ressouder les habitants, en infusant tout son disque dans la musique reine de D.C. Les rythmes emportent, chauffent les corps et échauffent les esprits, jusqu’à être interrompus par l’omniprésente violence. Au premier abord, la ville semble folle et divisée, mais l’enfant du D.M.V. veut démontrer que la jeunesse peut s’unir autour de ses richesses culturelles.
—————
GoldLink fréquente les rues bordées de briques et les clubs électroniques de Baltimore, qui après avoir inspirés sa « future bounce » résonnent dans les voix filtrées de son album. A la Virginie, il emprunte ses cloches métalliques et ses rythmes syncopés, comme sur son Kokamoe Freestyle qui évoque les Neptunes et tous ces producteurs qui ont grandi sous l’écho du go-go et des tambours de fanfares. Les visuels et les clips de Darius Moreno participent à l’hommage rendu à l’excentrique jeunesse locale, accro aux patchworks de Solbato et aux sneakers New Balance. Ses peintures charnelles, aux couleurs chaudes, sont calquées sur les affiches de la Ball Culture. C’est une façon de saluer les nombreuses soirées LGBT qui enflamment les nuits de ce triangle d’or. Mais c’est aussi à travers son casting d’invités que GoldLink espère unir les terres du D.M.V. Sur sa reprise de Roll Call du groupe go-go CCB, il invite Mýa, star du r’n’b à la fin des années 1990 et éternelle princesse de Washington.
Le planant Crew aurait pu sortir à l’époque de Mýa. Au côté de GoldLink et du crooner de Baltimore Brent Faiyaz, on y entend un timbre sans âge, qui nous parle de gang et des filles des beaux quartiers qu’il attire dans son ghetto. Ce gamin en fourrure, qui traine avec les auteurs des coups de feu qui ont fait fermer le Club U, s’appelle Marquis King.
Marquis King dit Shy Glizzy s’enorgueilli d’avoir grandi ici, sur la 37ème rue, quartier que beaucoup considère être le pire de Washington
En descendant vers le sud-est on entre dans un territoire laissé intact par les rénovations, au grand dam des promoteurs qui aimeraient voir les prix de l’immobilier s’envoler partout. Marquis King dit Shy Glizzy s’enorgueillit d’avoir grandi ici, sur la 37ème rue, quartier que beaucoup considèrent être le pire de Washington. Dans ses textes très personnels, il s’adresse d’abord à ceux qui, comme lui, ont souffert de la pauvreté et du système judiciaire américain. Ses chansons n’ont souvent pas d’autre but que de gonfler l’orgueil de ces gens, un pouvoir cathartique qui l’amène à être comparé à Boosie, C-Murder ou Soulja Slim, ces louisianais qui épongent les soucis de leur communauté.
—————
Avec sa voix pincée, Shy Glizzy rappe comme un adulte piégé dans un corps d’enfant. « Je ne suis pas un rappeur » répète-t-il à la manière de Beanie Sigel. Comme ce dernier, il considère peindre des images beaucoup trop vivaces pour être comparé aux autres. En référençant les rues, en citant nommément ses amis ou en piquant ses textes de détails vécus, il est vrai que Shy Glizzy nous force à voir D.C. comme si nous la regardions à travers ses yeux. Mais c’est avant tout son absence de retenue et son émotivité à vif qui touchent les locaux. En jouant de son flow fredonné, il plante ses aiguilles dans un canevas d’émotions très larges pour tisser ses toiles réalistes. Son agressivité est parfois de façade, pour dissimuler l’humour avec lequel il se moque de ceux qui ne représentent plus le « vrai D.C. », puis redevient brûlante pour menacer les quartiers rivaux. Et quand ses amis s’assoient au tribunal ou s’allongent au cimetière, le leader du Glizzy Gang redevient grave et mélancolique.
Aujourd’hui, la ressemblance est moins frappante car Glizzy a trouvé sa propre place autour de la table que partagent ses idoles
« Qui est le plus vrai ? Repose en paix Soulja Slim, libérez C-Murder » en ouvrant Young Jefe 2 sur ces mots, Shy Glizzy prouve qu’il a pleinement conscience de son héritage. Et sur l’interlude OG Call, depuis sa cellule d’Angola où il risque de croupir jusqu’à la fin de sa vie, C-Murder téléphone au prince du sud de Washington pour l’adouber. Malgré sa voix d’adolescent, Shy Glizzy paraît plus mature encore. Sur cette mixtape il énumère ce que son début de carrière a apporté : la nouvelle voiture de sa mère, les hivers moins rudes du Glizzy Gang désormais équipé en doudounes Moncler ou sa grande histoire d’amour avec la dénommée Blaidy. Après la pluie vient le beau temps, en somme. Shy n’est pas encore tout à fait au sommet, mais veut prouver par sa réussite que tout est possible pour les habitants du quartier. Douces et subtiles, les productions laissent le premier rôle à l’introspection. Les samples donnent une saveur plus east coast à sa trap fredonnée, et rappellent presque le B. Coming de Beanie Sigel. Il y a quelques années, il était impossible de parler de lui sans évoquer Boosie. Aujourd’hui, la ressemblance est moins frappante car Glizzy a trouvé sa propre place autour de la table que partagent ses idoles. À son tour de coopter. Sur Young Jefe 2 il salue Mozzy, Kodak Black, rend hommage au regretté Bankroll Fresh, et sur le récent The World Is Yours met en lumière Ralo et le tout jeune NBA YoungBoy.
En s’affichant sur l’album de GoldLink, il se montre prêt à œuvrer pour l’unité de D.C., lui qui il n’y a pas si longtemps jurait être le seul artiste respectable et loyal aux proverbiales rues du D.M.V. L’an dernier, il a même enterré la hache de guerre avec le bedonnant champion des quartiers nord-est.
Seul le sexe et la violence faisaient briller le fond de l’œil de Notorious B.I.G. Il en aurait fait les seuls sujets de ses textes si Puff Daddy ne l’avait pas convaincu que tout Machine Gun Funk doit être accompagné de son Juicy. Fat Trel est le Biggie d’une réalité alternative, d’un monde où il n’a jamais rencontré Diddy, où il est devenu à moitié sauvage et n’a jamais développé sa plume d’auteur hitchcockien. Seul le sexe et la violence font briller le fond de l’œil de Fat Trel, et à lui personne n’est venu expliquer que l’on pouvait s’intéresser à autre chose.
—————
Dans le nord-est de la ville, Fat Trel est connu pour trainer dans les soirées de Benning Road, torse nu, le corps tatoué et déformé par ses excès. Comme un gaucher balle au pied, il transforme ses défauts (de prononciation) en armes. Grâce à son accent qui déforme une consonne sur deux en « urr » il avale ses syllabes comme le Cookie Monster. Son débit ininterrompu et tout en allitérations désarticulées imbibe les productions comme du slime. Mais l’ectoplasme que Fat Gleesh laisse partout derrière lui n’a rien à voir avec celui des chasseurs de fantômes, c’est une mixture de champagne et de cyprine, de sueur et de sang. S’il a plus de baby mamas que de disques d’or, c’est évidemment à cause de cette vie de rock star décadente.
Pourtant, en plus d’être aussi charismatique que technique, il fait parti de ceux qui, avec Lil Durk à Chicago notamment, ont fait évoluer tout un pan du rap. Avec des titres comme Niggaz Dying en 2013, il mélange trap music, auto tune et nappes atmosphériques, pour donner naissance à ce rap de rue aérien et plein de spleen qui va conquérir le Monde, et la France en particulier via PNL.
En fier représentant de Washington D.C., il est évidemment arrivé à Fat Trel de rapper sur des percussions go-go.
Après un passage éclaire chez No Limit Records, Fat Trel rejoint Maybach Music Group. Depuis sa signature il y a quatre ans, il n’a toujours pas sorti d’album studio car sa présence sur le label semble avoir un tout autre intérêt. Populaire à Washington D.C., il y est VRP de luxe pour les marques de Rick Ross. En fin business man, ce dernier s’est offert un relais direct avec les rues du D.M.V., dont la population majoritairement afro-américaine correspond au cœur de cible de ses produits. Abreuvé gratuitement en bouteilles de Belaire et en repas Wingstop, Fat Trel s’empâte et s’enrichit tout en offrant gracieusement ses chansons violentes et dégueulasses. Sur la mixtape Fat & Ugly, Trel échange les jabs croisés et les ailerons de poulet avec Yowda, une autre signature fantôme qui exporte les produits MMG à Las Vegas.
En fier représentant de Washington D.C., il est évidemment arrivé à Fat Trel de rapper sur des percussions go-go. Sur She fell In Love il tape sur les fesses de son amoureuse au rythme des congas, et avec In My Bag il collabore avec l’un des champions du rap mariné dans le go-go, Wale.
A partir des années 1980, le go-go est si populaire à D.C. qu’il éclipse complètement le hip-hop. Et le meurtre de Fat Rodney, potentielle première star du rap local, n’a pas aidé le genre à s’y installer. Wale a démontré qu’il était possible de réussir dans le rap en venant de Washington. Il s’est appuyé sur sa culture et les sonorités régionales pour construire une discographie à la croisée des genres, et devenir une figure connue du grand public. La seule de toute l’histoire du rap à D.C.
—————
SHiNE ne célèbre pas les bientôt dix ans de carrière de Wale mais la naissance de sa fille. À là manière de Chance The Rapper avec son Coloring Book, il souhaite partager avec le monde son bonheur d’être devenu père. Lui qui est parfois gentiment ronchon semble apaisé par la paternité, et ce cinquième album est aussi son plus joyeux. Son écriture simplifiée laisse d’avantage de place à l’efficacité pop et aux mélodies que l’on peut chanter à un enfant. Il confie vouloir offrir le Monde et des voitures de sport à son bébé, dont la main boudinée attrape la Terre sur la pochette du disque. Mais très vite, Wale ne peut s’empêcher de repenser à son premier véritable amour, sa ville.
Sur Colombia Heights, il remonte la rue où s’est installée la communauté latino pour emprunter leur argot. Scarface Rozay Gotti chante les louanges des figures extérieures qui ont aidé au rayonnement de Washington. Rick Ross pour son investissement dans l’économie, Yo Gotti pour ses collaborations avec les locaux, et Scarface des Geto Boys, qui en plus d’être un habitué des concerts go-go a été bassiste du Backyard Band, un de ses groupes les plus mythiques.
Désormais chef de famille et en position de pouvoir transmettre un héritage, Olubowale Akintimehin s’est simplement tourné vers sa culture extra américaine, celle de ses parents
Produit par les français Picard Brothers, My Love et sa guitare naija a été au cœur d’une polémique idiote. Le youtubeur Anthony Fantano (alias « The Needle Drop ») reproche à Wale de surfer maladroitement sur la vague caribéenne. Ce dernier s’est fendu d’une réponse claire et nette : My Love n’a rien de caribéen puisqu’elle est inspirée par l’afro beat et invite le nigérian WizKid. Quant à l’accusation mal déguisée de pillage, elle est malheureuse, Wale étant d’origine nigériane lui-même et baignant dans ces musiques depuis son enfance. Désormais chef de famille et en position de pouvoir transmettre un héritage, Olubowale Akintimehin s’est simplement tourné vers sa culture extra américaine, celle de ses parents.
Parrain de la scène locale, il est tout naturel de retrouver Wale sur At What cost de GoldLink. Mais avoir réuni Kokayi, Wale, Shy Glizzy, Mýa et beaucoup d’autres sur un même disque relève du miracle dans une ville aussi divisée. Dommage que la récente incarcération de Fat Trel l’ait empêché de participer à cet immense armistice. Si la Juliette de Roméo GoldLink représente bel et bien la culture de D.C., alors contrairement à la tragédie de Shakespeare, dans ce remake la jeune femme est on ne peut plus vivante à la fin.
Illustrations : Bobby Dolla